accueil
... l'abbé
Clergeau ... tableau
des orgues ... inventaire
en images ... autres
instruments ....l'orgue
"de Sète" .. sources
... contact
l'abbé Clergeau
sa personnalité est plus complexe qu'il n'y paraît au premier
abord et même franchement surprenante : à la lecture des extraits
ci-dessous, il semble qu'il faille définitivement abandonner l'idée
d'un "facteur d'orgues", mais considérer le personnage comme
quelqu'un ayant su s'entourer de relations dans le monde ecclésiastique,
le monde littéraire scientifique et musical, celui des facteurs d'orgues
bien sûr, mais aussi par la suite, le monde politique et financier, gérant
de cinq ou six sociétés, (société des orgues, caisse
des bonnes oeuvres, crédit des paroisses, banque des dépots, société
des institutions de Boulogne et Saint-Mandé, et même la "société
des eaux de Calais "!) ce qui lui permit si on en croit les journaux de
l'époque (Journal des économistes juin 1867) de mener grand train
(traitement de 23000 fr et maison de campagne à Enghien) mais le conduisit
à la faillite, la prison et la fuite...
un personnage très Balzacien, en somme...
l'homme
d'église, l'écrivain
l'action
dans le domaine musical
l'inventeur,
les brevets
les
orgues Clergeau, facture, buffets, composition
l'homme
d'affaires, les sociétés et la faillite
l'homme
d'église, l'écrivain
 Nous n'avons hélas pas de portrait, mais il serait né à
Auxerre le 29 mars 1805, aurait été ordonné prêtre
en 1828, et pris sa retraite ecclésiastique en 1844 (archives diocésaines
de Sens, communication de J.M. Cicchero
facteur d'orgues) ; il est cependant toujours cité comme "chanoine
honoraire de Sens", avec toujours le titre d'abbé, y compris lors
de ses démêlés judiciaires...
Nous n'avons hélas pas de portrait, mais il serait né à
Auxerre le 29 mars 1805, aurait été ordonné prêtre
en 1828, et pris sa retraite ecclésiastique en 1844 (archives diocésaines
de Sens, communication de J.M. Cicchero
facteur d'orgues) ; il est cependant toujours cité comme "chanoine
honoraire de Sens", avec toujours le titre d'abbé, y compris lors
de ses démêlés judiciaires...
et on sait finalement assez
peu de choses de la jeunesse de l'abbé Clergeau : on trouve quelques
renseignements sur lui dans ses ouvrages, bien sûr, mais aussi dans les
journaux de l'époque, qui constituent une précieuse source d'information.
Reportons nous à
la dédicace de l'étude historique et biographique de Chateaubriand
parue en 1860, dans laquelle il explique :
<<...vouer sa gratitude à une troisième administration diocésaine
[de Moulins], en la personne de son ancien supérieur au petit séminaire,
M. L.. ,agé de 24 ans, lui-même étant alors agé de
13 ans>> voir l'extrait ci-dessous
(remarque : l'"école secondaire ecclésiastique"
ou petit séminaire de Moulins ayant ouvert en 1823 à Yzeure (Allier),
cela fixerait cependant une année de naissance postérieure à
1810, à moins qu'il n'évoque l'âge de son supérieur
(24 ans) à une époque précédant son entrée
au petit séminaire à treize ans).
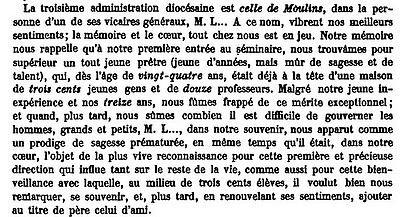 "Chateaubriand, sa
vie publique et intime, ses oeuvres"(Paris, Dufour, Mullat et Boulanger
1860)
"Chateaubriand, sa
vie publique et intime, ses oeuvres"(Paris, Dufour, Mullat et Boulanger
1860)
on trouve deux prénoms différents suivant les publications :
soit "Emile" (inv.35 page 338), soit "Jean-Baptiste-Germain";
mais c'est ce dernier qui revient quasiment toujours, par exemple ici :
<<Pour toute réponse à la nouvelle édition du factum de
M. Clergeau, chanoine de Sens, appuyé d'une consultation de Me Gressier, avocat,
au sujet du Symphonista, M. l'abbé Guichené,... adresse à ces messieurs la lettre
suivante... noms cités: François Guichené (Abbé.), Jean-Baptiste-Germain
Clergeau (Abbé.) Éditeur impr. É. Dupeyron, 1858 >>
de même, dans quelques
inventaires, dont celui cité, on trouve l'orthographe CLERGEOT; mais
dans toutes les publications consultées et les ouvrages imprimés,
le nom écrit est bien CLERGEAU, et Emile Clergeau est présenté
comme un "parent"; les renseignements ci-après attestent bien
de l'existence d'Emile Clergeau, qui apparaît comme étant le frère
de Jeanne-Alexandrine, seconde épouse de Dominique-Auguste Alizant, le
facteur d'orgues qui réalisa nombre des instruments vendus par l'abbé
Clergeau. (archives
en ligne de l'Yonne, site filae.com
et communication de J.MCicchero).
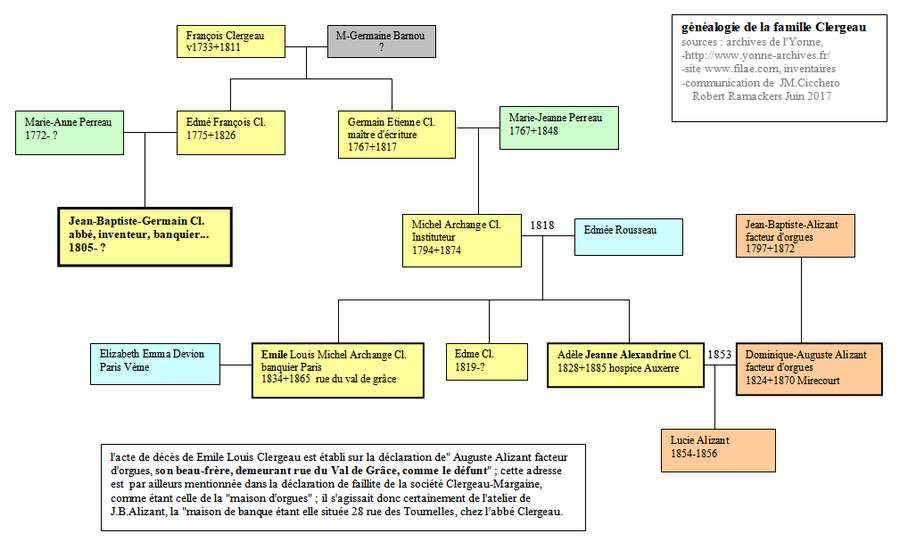
extrait
de l'arbre généalogique de la famille Clergeau en lien de parenté
avec l'abbé Clergeau
dans la revue "l'ami
de la religion et du roi" on apprend ensuite qu'il obtient une bourse de
la ville au commencement de ses études à Auxerre, puisque la mise
à disposition d'élèves méritants,de quinze livrets
de quinze francs est envisagée comme une sorte de "restitution"
:
<<..Mr l'abbé Clergeau, ..., vient de mettre à disposition
de l'autorité municipale de la ville d'Auxerre quinze livrets de quinze
francs chacun, de la caisse de prévoyance de cette ville, pour être
distribués aux élèves de toutes les écoles gratuites
sans distinction, qui s'en montreraient les plus dignes....Mr le maire faisait
ressortir aussi toute la délicatesse de l'action de Mr l'abbé
Clergeau, qui, ayant au commencement de ses études à Auxerre,
obtenu une bourse de la ville, semble ne voir dans son acte de munificence,
qu'une sorte de restitution..>>(ref:Gallica l'ami de la religion et du
roi)
il sera ensuite (peut-être
après d'autres nominations ailleurs ?) curé de Villeblevin (Yonne),
paroisse à laquelle il fait don en 1852 d'un "orgue de son système"
<<don d'un orgue
de 8 jeux à la paroisse de Villeblevin (Yonne): DIOCESE DE SENS. Nous
recevons la lettre suivante « Je vous pris de vouloir bien enregistrer dans
vos colonnes une nouvelle générosité de M. l'abbé Clergeau, auquet l'art et
les pompes religieuses doivent le système de transposition appliqué à t'orgue,
générosité non moins remarquable par sa valeur intrinsèque que par le motif
qui l'a déterminée. C'est à Villeblevin, dont alors il était curé, que M. Clergeau
a eu la première idée de la transposition, qui a pour l'effet de simplifier
le jeu de l'orgue, sans sortir des règles de l'art. La capitale n'a pas tardé
à apprécier cette importante innovation tant par ses artistes que par les encouragements
du ministère; une véritable révolution s'est faite dans la facture, et aujourd'hui
toute la France, depuis les cathédrates jusqu'aux plus simples hameaux, connaît
et apprécie le système de M. l'abbé Clergeau. On estime à près d'un Million
la valeur des instruments transpositeurs livrés depuis trois ou quatre ans.
Par reconnaissance envers Dieu, qui a permis un aussi grand succès, et dans
des circonstances, il faut le dire, aussi peu avantageuses pour les arts, M.
Clergeau vient de faire don à notre paroisse, témoin de son premier travail,
d'un magnifique orgue à tuyaux de son système et établi par ses soins.Il se
compose de 8 jeux de 8 pieds, prestant, bourdon, grande flûte, nizard(sic),
doublette, cornet, basse et dessus de trompette basse de clairon et dessus de
hautbois, etc. en tout près de 600 tuyaux. Transposition de 12 notes, tant au
clavier à main qu'au clavier de pédales, montre de trente-cinq (sic) tuyaux
brillants enchâssés dans une plate-face sculptée et de gracieuses tourelles
ornées de draperies en bois sculpté. La composition intérieure et extérieure
de ce bel instrument ne laisse rien à désirer. Cette donation est assez honorable
pour les arts et pour les artistes, assez généreuse par elle-même et par son
motif pour mériter une mention. Pour moi qui administre la commune depuis quarante-huit
ans, je vous laisse à devenir Monsieur le rédacteur, le contentement qu'éprouve
un vieillard de soixante-seize ans, pénétré d'un profond dévouement pour son
pays natal. L'éclat des pompes religieuses qui résulte d'un si bel accompagnement
réjouit ma vieillesse et couronne tous mes efforts en accomplissant tous mes
voeux. Veuillez, etc. Le maire de Villeblevin, Bourgouin>> (réf:Gallica
"l'ami de la Religion et du Roi 1852)
(notons qu'actuellement, c'est un orgue de Cavaille-Coll qui
se trouve à Villeblevin (inv.89 YO-40), mais on trouve à Champigny
(inv.89 YO-14) et Vinneuf (inv.89 YO-43), deux communes très proches,
deux orgues Clergeau : l'un d'entre eux proviendrait-il de Villeblevin, ou ce
dernier a-t-il été vendu à une autre paroisse ?)
mais les "libéralités"
de l'abbé Clergeau sont multiples :
-dons d'argent :
<<M.
l'abbé Clergeau, du clergé de l'Yonne, ex-aumônier de M. de Châteaubriand, et
auteur de l'orgue transpositeur, vient de donner à M. le ministre de la guerre
une somme de trois cents francs pour être distribués spécialement aux gendarmes
victimes plus ou moins de leur dévouement, lesquels n'auraient pas été récompensés
par un avancement immédiat ou de toute autre manière. Nous nous rappelons qu'il
y a quelques mois, M. l'abbé Clergeau faisait à la ville d'Auxerre un don de
750 fr., pour être distribués en brevets de la caisse de prévoyance aux élèves
pauvres des écoles primaires de cette ville, dans le but de populariser cette
institution.>>(réf:Gallica "l'ami de la Religion et du Roi
1851)
-contribution à
la construction de l'orgue de Choeur de la cathédrale de Sens :
<<...Un orgue d'accompagnement de quinze jeux distribués sur deux
claviers à mains et pédales et du système transpositeur
de M. L'abbé Clergeau vient d'être inauguré au choeur de
la Métropole de Sens, le jour de la sollennité de l'Assomption,
et de nouveau les 25 et 2? Août en présence de tout le clergé
du diocèse réuni pour la retraite et le synode...Ce magnifique
instrument, le plus complet qui existe au choeur de toutes nos cathédrales
de France, est dû aux soins persévérants et à la
générosité de M. l'abbé Clergeau, qui en a partagé
la dépense avec le gouvernement.Par cette bonne oeuvre, entre autres,
M. l'abbé Clergeau, chanoine de Sens...>>(ref:Gallica l'ami de
la religion et du roi 1855 juill.sept) (orgue Ducroquet 1854 inv.89 YO-34)
-lors du CONGRÈS pour la restauration du Plain-Chant et de la
musique religieuse 3 août 1860...
<<Ensuite
il annonce à l'assemblée que M. l'abbé Clergeau, membre du Congrès, a versé
entre les mains du trésorier, à titre de don et sans affectation spéciale, une
somme de 500 fr. L'assemblée charge le bureau de transmettre à l'abbé Clergeau
l'expression de sa vive reconnaissance...>>
il faut croire que le brevet
du mécanisme transpositeur déposé en 1845, adopté
par le facteur d'hamoniums Alexandre, lui avait rapporté de confortables
subsides... on trouve le chiffre de "un million" et même plus
loin, "trois millions" !...
<<... aujourd'hui toute la France, depuis les cathédrales
jusqu'aux plus simples hameaux, connaît et apprécie le système de M. t'abbé
Clergeau.on estime à près d'un million la valeur des intruments
transpositeurs livrés depuis trois ou quatre ans...>>(cité
au-dessus l'ami de la Religion et du Roi 1852)
haut de page
les écrits :
une "étude
historique et biographique de Chateaubriand" parue en 1860
 .........................................
......................................... 
"Chateaubriand, sa vie publique et intime, ses oeuvres"(Paris, Dufour,
Mullat et Boulanger 1860)
BNF Gallica
dans la préface, l'auteur adresse son hommage "au clergé
en général", puis à "l'administration diocésaine
de Sens", dont le vénérable chef, l'ayant un jour "surpris
dans l'organisation des choeurs de notre église", et "après
s'être rendu compte de nos moyens", lui fait l'honneur de "l'appeler
à sa cathédrale pour en faire l'application, ... , puis donner
la mission plus large de faire adopter ... ces moyens partout, pour la propagation
de la musique religieuse, au profit des pompes de l'Eglise."
ensuite, à l'adresse de celle de Paris, qui l'envoie auprès de
la personne de M. de Chateaubriand : << vous vous occupez d'art, votre
place est auprès du poète-écrivain>>
dans cette oeuvre très
lyrique ("Atala fut aux esprits...ce que le lever d'un beau jour est aux
ténèbres..."), après le récit de la vie et
des voyages, vient l'éloge de la défense du christianisme : <<...
L'apparition du Génie du Christianisme ne pouvait manquer d'obtenir en
France presque toutes les sympathies, après les funestes résultats
des livres impies de Voltaire, de d'Alembert, de Diderot...>> puis une
longue fresque historique sur l'époque mouvementée qui suivit
la révolution, les engagements politiques de Chateaubriand, et enfin
la retraite, la rédaction des Mémoires...
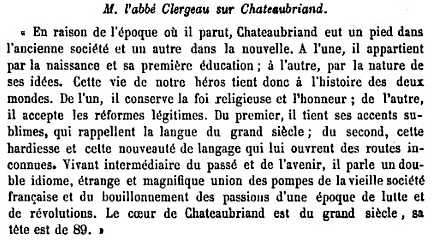 à rapprocher de l'orgue Clergeau très "ancien
régime", en plein milieu du XIXème siècle...
à rapprocher de l'orgue Clergeau très "ancien
régime", en plein milieu du XIXème siècle...
il est également
l'auteur d'un autre livre : "l'unique destinée de l'homme "1862
(chez l'auteur) réf: bibl.diocésaine de Dax
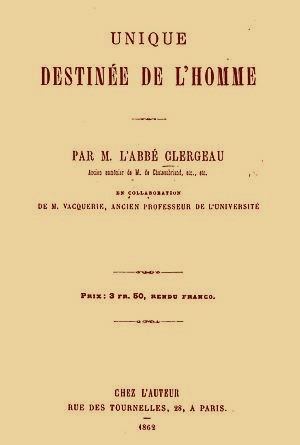 .....
.....
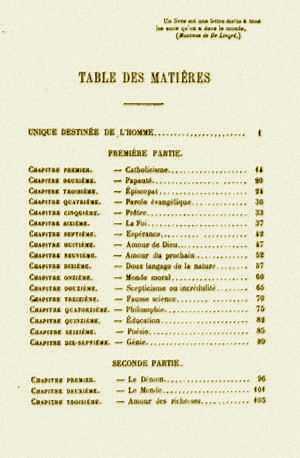
édité cette fois "chez l'auteur", qui se fait cette
fois éditeur...
les revues
l'abbé Clergeau fonde un journal "le drapeau catholique" mai
1860 ; cette publication posa quelques problèmes... on lit dans l'Histoire
critique et anecdotique de la presse parisienne :
<<...fondé et subventionné par l'abbé
Clergeau, ancien aumonier honoraire de Mr de Chateaubriand, auteur d'une vie
du chantre d'Atala, ancien chanoine de Sens, ancien associé d'Alexandre
Père et Fils, inventeur de l'orgue transpositeur, ancien fondateur de
la Caisse générale du Clergé S.G.D.G., ni des tribunaux,
ancien directeur des Eaux de Calais, créateur imaginaire du Tir National,
propriétaire rue des Tournelles du légendaire hôtel de Ninon
de Lenclos, ce journal était consacré à Jésus et
à Marie, sous la figure de Charles Marchal (de Bussy). On y houspillait,
en style de sacristain, Pierre Leroux, Proudhon, Louis Blanc, le Léonor,
directeur politique du Siècle, la philosophie, la révolution....Le
Drapeau Catholique fut amené devant la police correctionnelle 6ème
chambre, et reconduit à Sainte-Pélagie. ... Le Drapeau catholique
fut remplacé par la Gazette religieuse...L'abbé Clergeau, surpris
dans sa foi industrielle en fut quitte pour un billet de quelques centaines
de francs, et la religion catholique pour un journal honteux de moins...
... L'abbé Clergeau est un spéculateur de première force.
Intelligence agile, tempérament froid, il ne s'est élancé
dans le monde que pour y monter des affaires; il n'a mis de coté sa lourde
robe noire que pour nager avec aisance à travers la spéculation...
nous le reverrons plus tard à l'oeuvre dans les coulisses du journal
l'Orphéon...dont il est le deus ex machina. Mais que dites vous d'un
abbé de ce modèle, qui s'érige aujourd'hui en moraliste
et en protecteur de l'institution chorale?...>>
lire l'article complet dans : "Gazettes
et gazetiers : histoire critique et anecdotique de la presse parisienne
; deuxième année par J.F.Vaudin E.Dentu Paris 1863) page 157 et
suivantes
on notera ce trait de caractère <<"..spéculateur
de première force, intelligence agile, tempérament froid..."
>>
haut de page
l'action
dans le domaine musical
ayant déposé
un brevet et conclu un accord avec la manufacture d'harmoniums-melodiums Alexandre
aussitôt après, il est clair que le principal de son action consistera
à diffuser massivement ce système dans toutes les paroisses, en
prônant une évolution des pratiques musicales dans la liturgie.
mais ses prises de position en faveur de la suppression du plain-chant en faveur
de la musique provoquent de vives réactions :
dans LA
MAITRISE journal de musique religieuse : 5ème année . 1859-1860. <<Il
est tombé dernièrement entre nos mains une pièce extrêmement curieuse, et que
nous croyons devoir enregistrer dans la Maîtrise comme un incroyable monument
d'aberration de quelques membres du clergé, à l'endroit du chant grégorien.
Cette pièce est extraite d'un Prospectus de M. l'abbé Clergeau, inventeur de
l' Orgue transposileur , qui est fort populaire en France, dans les paroisses
rurales où il fait l'admiration des curés et de leurs naïves ouailles, mais
qu'un savant a cru apprécier avec justice , au nom de la science, en disant
très- carrément que cet instrument ne vaut rien. S'il est fâcheux pour un ecclésiastique
de s'exposer à subir un tel jugement, il est doublement regrettable de le voir
patronner une idée comme celle qui est produite dans la lettre que nous empruntons
à son Prospectus de 1858, et qu'il fait précéder de ce titre beaucoup trop remarquable:
Lettres sur la suppression du Plain-Chant. ...>> ...<< Ainsi, pendant
que des travaux sérieux préparent la restauration du chant douze fois séculaire
de l'Église, trois hommes investis de son sacerdoce [l'abbé Euvrard,
l'abbé Clergeau, l'abbé Prunier], se figurent faire une chose
utile à la Religion en le dépréciant, en déclarant sa succession ouverte au
profit de la musique, et, aveugles qui ne savent ce qu'ils font, se constituent
fossoyeurs d'une nouvelle espèce, et se hâtent de procéder à l'enterrement du
Plain-Chant>>
on le retrouve dans un congrès pour la restauration
du plain-chant :
dans "Le Ménestrel journal de musique 1860" : CONGRÈS pour la restauration
du Plain-Chant et de la musique religieuse. 2ème séance préparatoire
tenue à Paris, le vendredi 3 août 1860, dans les salons d'Érard, rue du Mail,
13 : don de 500 fr. pour se faire pardonner une publication peu appréciée
?
<<...Ensuite il annonce à l'assemblée que M. l'abbé Clergeau, membre du
Congrès, a versé entre les mains du trésorier, à titre de don et sans affectation
spéciale, une somme de 500 fr. L'assemblée charge le bureau de transmettre à
l'abbé Clergeau l'expression de sa vive reconnaissance.>>
<<...Après une discussion à laquelle prennent part MM.
Allier, Pelletier, de la Fage, d'Ortigue, Dhibut, Schmitt, Calla, Gautier, Arnaud,
de Geslin, Jules Bonhomme et autres, il est résolu que le bureau exprimera à
M. l'abbé Clergeau l'étonnement qu'a causé à l'assemblée la lecture du prospectus,
bulletin n° 41, attendu que dans cette publication, où M. Clergeau excipe de
sa qualité de membre du Congrès, l'idée mère du Congrès est totalement dénaturée.
Le bureau est également chargé de prier M. l'abbé Clergeau d'insérer dans le
bulletin le plus prochain une rectification, et de lui donner l'assurance que
le Congrès, pour la restauration du pain-chant et de la musique d'église, ne
peut que se montrer fidèle à son nom...>>
on rencontre également l'abbé Clergeau dans diverses autres publications
:
MONOGRAPHIE UNIVERSELLE DE L'ORPHÉON SOCIETES CHORALES Librairie
Ch, DELAGRAVE, 15, rue Soufflot, Paris. <<1856. — J. Simon ( -1868) eut
l'idée de mettre au concours, entre les instituteurs de France, un mémoire traitant
des deux points suivants : 1° Quelle peut être l'influence du chant choral et
de la musique sur les populations rurales? 2° Qîiels sont les meilleurs moyens
d'en favoriser la propaç/ation? Le prix offert consistait en une médaille d'argent
et une somme de deux cents francs. Quantité de manuscrits très minutieusement
élaborés parvinrent. Une commission d'examen formée de Delsarte, président;
Félicien David, Delaporte, Elwart, Antony Béraud, l'abbé Clergeau, L. de Rillé,
Giuseppe Danièle, F.-J. Simon, Vauthier d'Halluvin et Camille de Vos, membres,
fut chargée de les compulser.>>
7 octobre 1860 JOURNAL DES INSTITUTEURS 3ème année
n°41
<<...ne se trouveront désormais que chez leur auteur, M. JOUAN, instituteur
à CARO (Morbihan), les livres ci-après (vivement recommandés par M. l'abbé CLERGEAU)
et dont il sera, sous peu, parlé avantageusement dues ce Journal. Le prix en
a été réduit en faveur de MM. les Instituteurs : 1° Recueil de Mélodies d'église,
40 centimes, au lieu de 1 fr. (4 fr. la douzaine.) 2° Nouvelle Messe, 20 c,
au lieu de 60 c. (2 fr. la douzaine.) 3° L'Art d'accompagner le Plain-Chant,
1 fr., au lieu de l fr. 50c. 4° Méthode d'Orgue-Transpositeur, 1 fr. 80 c, au
Heu de 2 fr. 50 c, Payer en timbres-poste, si l'on veut.>>
« Le journal nouveau contribua
encore très effectivement à la formation nécessaire d'un répertoire national,
par l'ouverture périodique de concours de composition musicale qui procurèrent
à de nombreux compositeurs populaires l'occasion de mettre en lumière leurs
talents spéciaux et otlrirent ainsi aux sociétés un large choix d'œuvres nouvelles
écrites dans une note répondant à leurs aptitudes particulières. « Sur la fin
de 1861, Delaporte abandonna la direction et la propriété de son journal à quatre
de ses plus fidèles collaborateurs et soutiens : F.-J. Simon, déjà rédacteur
en chef; P. Torchet, directeur-inspecteur des orphéons de Seine-et-Marne; F.
de Marie, pianiste-compositeur distingué, et l'abbé Clergeau. » (Ab. Simon.)
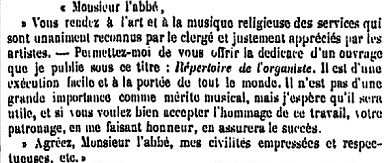 "l'univers musical" dédicace de Fessy 1er janvier
1856
"l'univers musical" dédicace de Fessy 1er janvier
1856
...
haut de page
l'inventeur,
les brevets
les recherches de mécanismes à
adpater aux instruments fabriqués par la maison Alexandre se faisaient
dans son luxueux appartement du 28 rue des Tournelles (Hôtel particulier
de Sagone où résida Ninon
de Lenclos), ce qui occasionnait des nuisances
sonores insupportables pour les voisins qui lui firent un procès ! Dans
la "gazette des tribunaux, aout 1853", l'avocat des propriétaires
y résidant , indiquait que <<les
transformations harmoniques subies incessamment par les nombreuses orgues voiturées
sans relâche de l'appartement de M. l'abbé Clergeau aux ateliers
de ses facteurs, et vice-versa, avaient converti cette habitation célèbre
par ses souvenirs historiques, en une véritable maison de commerce...>>
s'agissait-il de melodium Alexandre, livrés chez lui pour y adapter son
transpositeur et sa plaque ? On trouve aussi la description de mécanismes,
qui superposés au clavier, permettaient de réaliser des accords
tout faits pour l'accompagnement des chants. La mise au point de ces mécanismes,
devait mettre les oreilles de ses voisins à rude épreuve, pour
qu'ils saisissent la justice!

l'hôtel de Sagonne 28 rue des Tournelles, et la façade boulevard
Beaumarchais
le transpositeur
les prémisces (Roller,
Blanchet, Muller...) : ce dispositif bien connu de nos jours est sans doute
apparu bien avant le dépot de brevet, et sous plusieurs formes (dans
le système de Roller, le clavier se déplaçait latéralement
sous les cordes d'un piano...);
on lit par exemple dans
le Courrier des Alpes du 25 mars 1862 :
<<Vous savez quelle, vogue ont aujourd'hui les harmoniums,
et quel immense service, malgré leur grande infériorité vis-à-vis des orgues,
ils ont rendu à la musique religieuse. Vous savez aussi le bruit qu'on a fait
en France, au sujet du clavier-transpositeur et le parti qu'a tiré de
cette, invention M. l'abbé Clergeau, dont je ne méconnais point les mérites.
Et bien, M. Reydet, avant qu'aucun harmoniun existât encore dans notre pays,
et par la seule étude d'un accordéon, n'avait pas seulement imaginé et fabriqué
en entier, à lui seul, deux harmoniums dont le dernier est de cinq ou six jeux
complets et des plus puissants, mais il y avait encore appliqué le mécanisme
d'un clavier-transpositeur. Je puis attester d'avoir vu tout cela chez ce bon
curé de Viuz-Faverges, dont l'hospitalité était des plus cordiales et d'avoir
touché son clavier-transpositeur, bien des années avant que les journaux français
nous eussent parlé de la découverte de M. l'abbé Clergeau et de son brevet d'invention.
Comme il est juste de rendre à chacun ce qui lui appartient, ne fût-ce que dans
l'intérêt de l'histoire de l'art, j'espère, monsieur le directeur, que vous
voudrez bien accueillir ces petits détails qui sont honorables pour notre Savoie
et que vos abonnés, j'aime a le croire du moins, ne liront pas sans quelque,
satisfaction. J'ai l'honneur d'être, etc. L'abbé G.-F. PONCET>>le
courrier des alpes, 25 mars 1862 (www.memoireetactualite.org)
mais c'est sans doute après le dépot du brevet en 1845, et l'application
aux harmoniums, (accord avec la maison Alexandre), puis aux orgues que ce système
va se généraliser jusque dans les plus petites paroisses; on notera
que ce qui est appelé "orgue transpositeur" dans les publications,
est en fait un harmonium à clavier transpositeur. Les harmoniums "Clergeau"
étaient exposés dans ses locaux, mais de même que pour les
orgues qui nous préoccupent, ne s'agissait-il pas d'instruments sous-traités,
et revendus sous la marque Clergeau, en raison de la présence du clavier
transpositeur?
 réf. BNF
Gallica .......
réf. BNF
Gallica ....... 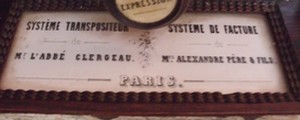 http://harmonium.forumactif.org/
http://harmonium.forumactif.org/
-dans les compte-rendus du procès en
contrefaçon que Debain fit à Alexandre entre 1840 et 1845, portant
notamment sur l'appellation "harmonium", on lit dans la gazette des
tribunaux de juillet 1858 :
<<l'abbé Clergeau s'est mis à la tête d'une grande
exploitation d'orgues, et répand ses prospectus (et quels prospectus!)
à un nombre effroyable au moyen d'une licence qu'il a obtenue du ministère
des finances et qui l'affranchit du droit de timbre.Mr l'abbé Clergeau
a des rapports d'affaire avec Alexandre, et sous le couvert de l'abbé
Clergeau, Alexandre fait prôner ses instruments, auxquels il donne en
ce cas avec une sécurité apparente, le nom d'harmonium....>>
-gazette
des tribunaux de février 1859 :
<<...l'abbé Clergeau n'est ni l'agent, ni le représentant
de la maison Alexandre, mais bien un client acheteur...les instruments qui lui
ont été livrés, ou l'ont été à des
tiers par ses ordres, ses clients personnels, lui ont été vendus
à lui-même...>>
<<l'abbé Clergeau s'est mis
en communication avec les membres du clergé pour la fourniture d'orgues
à bon marché pour les églises de campagne. Il a sa maison
séparée, ses prospectus;
s'il prend le nom harmonium, Mr Alexandre n'y est pour rien. A Mr Debain de
le poursuivre si cela lui convient...>>
afin de diffuser largement les bienfaits de son invention, il propose
<<Nota 1°) : "...de se rendre lui-même dans
chaque chef-lieu, à l'époque des retraites, s'il y est autorisé...
Mr le Ministre des Cultes, à peine informé du travail de l'auteur,
a de suite commis l'un des plus grands organistes de la capitale Mr Simon ...
inspecteur des orgues de toutes les cathédrales de France, pour examiner
le mécanisme de Mr Clergeau. ... Mr le Ministre des Cultes qui, sans
aucun doute en recommandera l'emploi aux respectables chefs des diocèses,
... ".>> Mécanisme musical transpositeur pour orgue et piano
par Mr Clergeau, Sens imprimerie Thomas-Malvin 1845
et il est précisé ensuite :
<<Nota 2°) : " Le prix des orgues expressives
Melodium, avec transpositeur, variera de 150 à 750 fr. Les moins forts
produisent un effet suffisant pour les églises ordinaires de la campagne>>(
note : l'orgue Melodium est fabriqué par la maison Alexandre.)
En prétendant pouvoir former un "organiste de campagne" en
quelques semaines, grâce à son invention, l'abbé Clergeau
va sans sûrement trop loin, et provoque des réactions assez vives
:
dans la Revue de la Musique religieuse, populaire et classique
fondée et dirigée par F. Danjou organiste de la métropole de Paris. (Paris,
rue Saint-Maur-Saint-Germain, 17. 1845) Première année 1845 pp ; 175-179 : (I
mai 1 13/1845) « Mécanisme musical transpositeur pour orgue ou piano, par M.
Clergeau, curé de Villeblevin, diocèse de Sens(yonne) ses effets sur l'orgue
et sur le piano, ses conséquences dans le monde musical suivi d’une lettre appréciative
de Mrg. L’Archevêque de Sens; d’une lettre de M. l’inspecteur de l’instruction
primaire; d’un rapport fait à M. le ministre des cultes par M. Pollet, organiste-accompagnateur
de Notre-Dame de Paris. ... voici en peu de mots en quoi il consiste : M. Clergeau
a inventé un mécanisme pour opérer sur un clavier la transposition dans tous
les tons. En fait, ce mécanisme peut être ingénieux, il petit être utile dans
quelques cas, et déjà MM. Roller et Blanchet, facteurs célèbres de piano, en
ont fait l’application il y a plusieurs années. Je ne sais en quoi la découverte
de M. Clergeau diffère de celle de M. Roller; le moyen importe peu, le résultat
est le même ... ... Mais il ne s’arrête pas là, et dans un prospectus pompeux,
dont on a lu le titre en tête de cet article il annonce la prétention d’accomplir
un progrès immense, de changer la face du chant religieux en France, à l’aide
de cette découverte. Il suffira d’acheter à M. Clergeau un orgue, une méthode
de plain-chant, une méthode de musique, il donnera son mécanisme par-dessus
le marché, et tout sera sauvé, l’art, le culte, la religion. ... >>
cité par Robert Martin dans "les ateliers de l'abbé Clergeau" le monde de l'orgue
http://monde-orgue.cutureforum.net
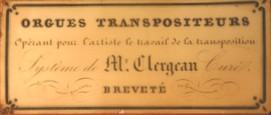 in étude
de Maurice Rousseau site http://www.plenumorganum.org/
in étude
de Maurice Rousseau site http://www.plenumorganum.org/
à l'occasion de l'exposition universelle de Paris de
1855 et du rapport publié par François-Joseph Fétis, on
apprend que grâce au "concours actif du clergé", il a
pu placer un très grand nombre d'instruments (harmoniums à transpositeur),
et que cela a rapporté "trois millions" en l'espace de quatre
années...
<<La transposition sur l’orgue par un moyen mécanique a beaucoup préoccupé
les facteurs il y a environ dix ans, parce que son utilité est fréquente à l’église,
en raison des voix qui composent le choeur, et parce que le diapason actuel
n’est plus celui de l’orgue ancien. [27] M. l’abbé Clergeau, aujourd’hui chanoine
de Sens, produisit, en 1845, un mécanisme de ce genre appliqué aux orgues à
anches libres, et obtint un succès dont il n’y a pas d’exemple, par le grand
nombre d’instruments de ce genre qui lui furent demandés. Le concours actif
du clergé lui a procuré le placement de ses orgues dans les plus petites communes.
Tel a été l’appui que son entreprise a trouvé partout, que, dans le court espace
de quatre années, la vente de ses instruments a produit trois millions. M. l’abbé
Clergeau a rendu de véritables services au culte, ainsi qu’à la musique, en
répandant le goût du chant accompagné, là où il était inconnu, et faisant connaître
le chant de l’harmonie à des populations qui n’en avaient pas même l’idée...>>
François-Joseph FÉTIS Exposition universelle de Paris, en 1855 Fabrication des
instruments de musique Rapport Exposé historique de la formation et des variations
de systèmes dans la fabrication des instruments de musique IIIe SECTION 1re
Partie Orgues d’églises et de chapelles page 39 Études
et documents en ligne de l’IRPM
mais aussi : <<...Parmi les instruments soumis à l’examen
du Jury de la XXVIIe classe, celui que M. Théodore Nisard, ancien organiste
de Paris, a exposé, a fixé son attention. L’auteur l’annonçait comme un nouveau
système d’orgue, avec un nouveau clavier qui transpose instantanément, sans
aucune préparation, et d’une manière tout à fait distincte, la musique moderne
et le plain-chant. Cet instrument devrait donc inspirer de l’intérêt au Jury,
sous le rapport de la sonorité, comme sous celui de la transposition, qui doit
être en effet très-différente dans le plain-chant de ce qu’elle est dans la
musique moderne...>>
<<Ces deux difficultés qui, à d'autres temps, auraient
pu être insolubles, ne le sont point dans l'état actuel de l'art. Est-il quelqu'un
, en effet, qui puisse ignorer encore les prix si réduits auxquels on peut obtenir
aujourd'hui des orgues, surtout depuis qu'on y a substitué l'harmonium? Quelle
est la paroisse qui ne pourrait réunir 500 fr., par exemple, pour acquérir au
moins un orgue-lranspositeur de M. l'abbé Clergeau? Dans les trois quarts des
communes , pour arriver là, il suffirait de le vouloir>> www.memoireetactualite.org
le courrier des alpes 22 décembre 1855
 forum harmonium http://harmonium.forumactif.org/
forum harmonium http://harmonium.forumactif.org/
(l'orgue transpositeur est en fait un harmonium à clavier transpositeur)
l'invention est citée dans "l'histoire
chrétienne des diocèses deFrance, de Belgique, de Savoie et des
bords du Rhin Paris (1855 Clavel de Saint-Geniez : <<Les
orgues ... aujourd'hui, les plus petites villes en ont : et un grand nombre
de simples paroisses rurales s'imposent le sacrifice de s'en munir afin de procurer
les charme de sa musique aux modestes paysans qui assistent aux offices. Cet
usage se répand de plus en plus depuis que Monsieur l'abbé Clergeau,
chanoine de Sens, y a introduit le précieux perfectionnement du transpositeur:
au moyen duquel, avec quelque attention, toute personne intelligente, peut facilement
en faire sortir les principales mélodies des solennités religieuses...>>
le "symphonista" de l'abbé François Guichené
bénéficiera aussi de l'invention de Clergeau
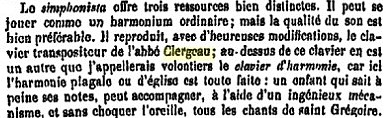 journal "l'univers musical" Paris Bruxelles 1er Janvier
1856
journal "l'univers musical" Paris Bruxelles 1er Janvier
1856
CONGRÈS SCIENTIFIQUE DE FRANCE. VINGT-CINQUIEME SESSION. Auxerre,
chef-lieu du département de l'Yonne, du 1er au 5 septembre 1858 ...
LISTE ALPHABÉTIQUE DES MEMBRES DU CONGRÈS SCIENTIFIQUE... CLERGEAU (l'abbé,)
à Paris...
RAPPORT DE LA COMMISSION NOMMÉE PAR LE CONGRÈS SCIENTIFIQUE DE FRANCE POUR EXAMINER
L'EXPOSITION DE l'INDUSTRIE DU DÉPARTEMENT DE L'YONNE.<<dans la salle
n°9...Un piano à articulation améliorée, présenté par M. Viollet, un buffet
en chêne sculpté de M. Bigot, l'orgue transpositeur si bien connu et si apprécié
de M. l'abbé Clergeau, un excellent orgue d'église de M. Chazelles, d'Avallon,
remarquable par la simplicité de sa construction et la puissance sonore et harmonieuse
de ses jeux...>>
autres brevets :
-brevet anglais (caster
wheel ?) (traduction incertaine: roulettes? roulements? à rapprocher
de l'invention de l'abbé François Guichené (roulement à
cylindre ou "boite à chapelet" destiné à améliorer
le balancement des cloches)
<<1648. And to Michael Henry, of 84, Fleet-street,
in the city of London, Patent Agent, for the invention of " improvements in
the construction of a certain description of castor, and in apparatus for manufacturing
certain parts of such castors, which apparatus may also be applied for producing
rounded bodies for other purposes." — A communication to him fromabroad by Jean
Baptiste Germain Clergeau, of 33, Boulevard Saint Martin, Paris, France. On
their several petitions, recorded in the Office of the Commissioners on the
27th day of June, 1861. >>page 2965 The London Gazette 19 juillet 1861
-brevet bec de gaz
dans la "Revue anecdotique des excentricités contemporaines"
(1er sem. 1860 nouvelle série tome 1er ) on lit page 178 à 180
que <<Mr l'abbé Moigno, rédacteur du savant
magazine Cosmos"mit l'inventeur [le frère Joachim] en rapport avec
l'abbé Clergeau, qui ... apporta les fonds nécessaires, et mit
son exploitation en pleine prospérité, après en avoir confié
l'administration à un de ses parents.>>...
<< Enfin,
Mr l'abbé Clergeau, parait disposé à seconder de ses capitaux,
tout invention nouvelle reposant sur des choses sérieuses. C'est ainsi
qu'il vient de faire des affaires d'or avec le frère capucin Joachim,
inventeur d'un nouveau bec de gaz qu'on peut admirer à la bibliothèque
Sainte-Gènevieve ... le bec susdit économise 40% de combustible...
Ici Mr l'abbé Clergeau donne tout l'essor à sa causticité
: " nous avons trouvé dit-il qu'il y avait du piquant à voir
un capucin donner de la lumière à notre siècle!">>
mais il va plus loin dans
sa réponse, s'éloignant assez du style de la "vie de Chateaubriand"
...
<<Aussi ferons nous
tout ce qui dépendra de nous pour faire ressortir un fait aussi remarquable
et pour l'opposer aux inutilités verbeuses, ne produisant jamais
rien de bon, de cette foule d'écrivassiers et de bavards qui ne
songent qu'à attaquer, à détruire... >>
et l'auteur de l'article de conclure :<< on voit
que Mr l'abbé Clergeau en vrai banquier n'oublie personne dans le règlement
de ses comptes ... >>
-selon la Gazette des tribunaux de février
1860, constitution d'une société en nom collectif entre M. Hippolyte
Monier (1808-1875, inventeur, notamment d'un bec de gaz économique, demeurant
à Paris, 5 rue du Grands Chantier, enterré au Père-Lachaise)
et de M. jean-baptiste-Germain Clergeau, (Paris, 28 rue des Tournelles) pour
l'exploitation et la vente des brevets appartenant à Mr Monier, pris
ou à prendre...
<<...les dits brevets ayant pour objet un bec de gaz dont les avantages,
celui entre autres de donner une économie de combustible de trente pour cent,
sont énumérés auxdits brevets. La raison et la signature sociales seront : MON1ER
et ?. Chacun des associés aura la signature sociale, mais ne pourra s'en servir
que pour les affaires de ia société, et pour les opérations ne dépassant pas
cinquante francs ; au delà de cette somme de cinquante francs, la signature
des deux associés sera nécessaire, pour la validité des engagements. A l'article
3, M. Clergeau s'est réservé le droit de substituer en son lieu et place, sous
sa responsabilité M. Emile CLERGEAU, son parent, ou tout autre, pour la signa
ture sociale. Par procuration, en date du premier février mil huit cent soixante,
enregistré le premier lu même mois à Paris, folio 40, case S, par le receveur,
qui a perçu deux francs vingt centimes, décime compris, M. Jean-Baptiste-Germain
Clergeau usant de cette faculté, donne pouvoir à M. Emile Clergeau de le remplacer
pour la signature sociale dans les conditions et limites fixées par l'acte de
société, lequel pouvoir aura son effet à partir du premier juin mil huit cent
soixante. Le siège de l'établissement social est établi à Paris, rue du Grand-Chantier,
5. La durée de la société est fixée à douze ans, à par tir du premier février
mil huit cent soixante. Pour extrait : Approuvé : Lu et approuvé, etc..>>
il est clair que le personnage
s'est enrichi, et brasse maintenant au moins autant d'affaires que de littérature;
d'autant que précédant ce qui vient d'être cité,
on lit page 177 de cette même "Revue anecdotique des excentricités
contemporaines" que
<< ... Mr l'abbé Clergeau, ancien aumonier etc..publie depuis quatorze
années un Bulletin financier destiné à indiquer à
ses vénérables collègues les placements de fonds qu'il
croit les plus avantageux par son entremise...>>
depuis quatorze années,
soit depuis 1846, c'est-à dire dès après le dépôt
du brevet du mécanisme transpositeur, et à l'époque de
son accord avec la maison Alexandre...est-ce à dire que le succès
de cette "invention", ou surtout de sa diffusion massive, compte tenu
de ses appuis dans le clergé, auprès du ministre des cultes, et
peut-être même du ministre de l'instruction publique, l'a conduit
à profiter de ce "réseau" pour se forger une clientèle
pour des placements prometteurs ? Plusieurs fois, les évêques ont
du remettre de l'ordre dans ce qui a été appelé du "trafic
de messes" ou d'indulgences (commandes massives de messes par des congégations
plus ou moins complaisantes...), les sommes collectées dans ce but n'étant
pas toujours affectées au repos des âmes...
c'est cet aspect "homme
d'affaire" sera évoqué plus loin, et qui le conduira avec
ses associés, à la faillite et à la condamnation en correctionnelle
...
haut de page
les
orgues Clergeau
faisons une parenthèse
dans la vie riche en évènements de l'abbé Clergeau, pour
s'arrêter sur ces instruments qu'il a réussi à placer de
la Corse à la Belgique, et soyons lui reconnaissant d'avoir choisi des
facteurs compétents qui ont su réaliser des orgues, dont un grand
nombre fonctionne encore, après restauration, certes, mais quel orgue
peut traverser un siècle et demi sans de nécessaires travaux d'entretien
ou de remise en état
?
nous ne dirons rien par contre des harmoniums avec transpositeur, largement
décrits par ailleurs (www.harmonium.forumactif.net, www.harmonium.fr,
etc...) même si on peut penser que leur commerce est pour une part importante
dans l'enrichissement de l'abbé Clergeau (rappelons que la production
des grandes manufactures d'harmonium s'est élevée à plusieurs
centaines de milliers d'instrument !)
la facture des "petites orgues de campagne" après
1830
les caractéristiques des orgues Clergeau ont peut-être en fait
leurs racines dans les courants de la facture parisienne autour de 1830 ; c'est
ce qui ressort de la communication de Philippe Hartmann lors du Symposium sur
les grandes dynasties de facteurs d'orgues Lorrains :
<<...En gros, cela a surtout donné les instruments à mécaniques
à bascules et à éventail, avec des layes qui n'ont plus de boursettes mais des
fils traversant une plaque de métal. On abandonne également les ressorts libres
sur une des branches, que les Callinet ont conservé, et on adopte les ressorts
à pincettes, à 2 pointes qui rentrent dans un trou, tant dans la soupape que
dans le guide. Tous ces petits détails montrent un goût pour une nouvelle mécanique,
nécessairement attachée à des claviers à bascules, faisant oublier la mécanique
suspendue précédente. C'est là qu'on s'aperçoit que les Callinet ont conservé
un type de construction archaisant. Les facteurs "modernes" de 1830 feront donc
ce type d'orgues de campagne; certains sont signés de Stoltz, d'autres ont été
répandus par l'abbé Clergeau. Souvent, ces instruments portent des noms de revendeurs;
en FrancheComté, un nommé Henry, marchand de piano, a signé beaucoup d'orgues
sans en construire un seul. C'est souvent difficile de savoir qui les a vraiment
construits, et je me suis demandé si tout cela ne venait pas d'un des frères
Verschneider, qui devait fournir beaucoup de ses collègues. Les Verschneider
ont très bien pu travailler à Paris et aussi centraliser une construction chez
eux, qui a pu être revendue par des relations parisiennes ou par des amitiés
avec d'autres facteurs...>>
Fédération Française des Amis de l'Orgue - Orgues en Lorraine-Mosellane
- Symposium Les grandes dynasties de facteurs d'orgues Lorrains (Ed Organa Europae
BP16 88101 SAINT-DIE CEDEX) extrait de : COMMUNICATION de M. Philippe HARTMANN
St-Avold Samedi 9 Juillet 1988.
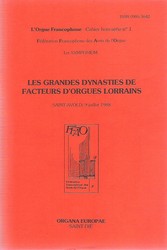 Ed Organa Europae BP16 88101 SAINT-DIE CEDEX
Ed Organa Europae BP16 88101 SAINT-DIE CEDEX
c'est par exemple le cas de l'orgue de St-Pierre de Limours,
construit par les frères Damiens (Eure) en 1865, dans lequel on retrouve
un certain nombre de ces caractéristiques : mécanique à
balancier en éventail, bourdon tout en bois, avec lèvre inférieure
en chêne et manchons trapézoïdaux, doublette et dessus de
hautbois . <<Il représente un courant de facture un peu « archaïsant »
à une époque où se développent des méthodes de construction nouvelles. Les Frères
Damiens avaient préféré recourir à des techniques éprouvées depuis longtemps.>>
conclut Pierre Dumoulin (inv77 Klincksieck éd.). Ou encore l'orgue de
l'église de Montpon (Dordogne), attribué "sans doute à
Leymarie et Trouillet, anciens élèves de Callinet" (site
des amis des orgues de Montpon) dont la première composition était
: Montre - Bourdon - Prestant - Nazard - Doublette - Tierce - Basse de Clairon
et Dessus de Hautbois, montre, prestant et anche coupés en B et D). On
pourrait ainsi multiplier les exemples et trouver à travers la France
de nombreux petits instruments possédant ces caractéristiques.
et en effet, on retrouve dans les orgues Clergeau la mécanique
à bascule en éventail (mécanique anglaise) moins complexe
à mettre en oeuvre qu'une mécanique suspendue avec son abrégé,
la plaque de métal percée qui tient lieu de boursettes etc...
qui caractériseront donc cette "nouvelle facture" (Verschneider
Abbey); le renouveau liturgique et le besoin de petits instruments adaptés
aux églises de campagne ou aux paroisses modestes fera le reste : l'abbé
Clergeau a certainement pressenti un "marché", et l'idée
d'adapter un clavier transpositeur qui facilitera le travail d'un organiste
aux compétences modestes lui permettra de placer ses orgues de la Belgique
(Vinalmont, Wallonie) à la corse...
un revendeur et un (ou des?) sous-traitants...
les caractéristiques
particulières sont bien résumées dans les inventaires du
Limousin (Robert Martin) et des Vosges (Christian Lutz), qui parlent de Clergeau
en tant que "revendeur" des instruments fabriqués par Auguste
Alizant :
<<- construction attribuable à "l'école de Mirecourt",
mais achetée auprès d'un "revendeur" (Clergeau ?, Le Logeais ?) pour les églises
de Felletin et Vallières. Pour l'église de Bourganeuf, bien que le buffet soit
identique aux instruments sus-nommés, la partie instrumentale possède des éléments
plus anciens. Nous sommes ici en présence d'un revendeur, chanoine honoraire
de la cathédrale de Sens, ancien aumônier de M. de Châteaubriand, 28 rue des
Tournelles, à Paris, également rédacteur et directeur du Bulletin de Musique
Religieuse. Les archives de la cathédrale de Sens, en 1852, font état à l'occasion
de la construction d'un orgue de chœur, de M. l'abbé Clergeau, curé de Villeblevin,
inventeur du clavier transpositeur et connu avantageusement dans le monde artistique,
qui fait don de 5 000 F pour la réalisation du projet. Mais c'est sans doute
vers les Vosges et l'école de Mirecourt qu'il faut se tourner pour trouver le
fournisseur de ce prêtre, dont les instruments possèdent de grandes similitudes
avec la facture des Callinet de Rouffach. Les recherches effectuées par Christian
Lutz sur les facteurs d'orgues vosgiens, nous apportent de précieux renseignements.
En effet ont retrouve un facteur d'orgues Auguste Alizant (1824-1870), fils
de facteur d'orgues, qui épouse en seconde noce vers 1853, une demoiselle Jeanne-Alexandrine
Clergeau. Les archives du Tribunal de commerce de Mirecourt font d'ailleurs
état en 1867 de la faillite de Clergeau et Alizant à Paris. Le chanoine assure
donc la commercialisation de ce que fabrique Alizant, les aléas d'un mariage
ont donc créé une association quasi familiale, et le religieux usera de ses
titres de chanoine et l'aumônier de Chateaubriand, pour se créer une clientèle
dans toute la France, puisque de nos jours encore on rencontre dans un grand
nombre de départements de petits instruments au buffet si caractéristique. >>
Inv.Limousin 1993 ASSECARM EDISUD
<<...De fait, les orgues construits par Auguste Alizant
dans les Vosges (Aouze et Saint-Elophe), commandés à Jean-Baptiste Alizant,
montrent d'étonnantes similitudes avec les orgues de Clergeau, au point que
l'on peut se demander si les orgues signés Clergeau n'étaient pas fabriqués
par Alizant à Mirecourt, l'abbé Clergeau n'en assurant que la commercialisation.
Les déplacements d'Auguste Alizant à Tours en 1850, au Havre en 1851, à Auxerre
en 1854 (où lui naquit une fille, Lucie, qui mourut à Mirecourt en 1856), pourraient
peut-être aider à identifier son travail. Les archives du tribunal de commerce
de Mirecourt font état en 1867 de la faillite de Clergeau et Alizant à Paris,
qui étaient alors en affaire avec Didier Poirot....>> inv.Vosges
le(s) buffet(s) ...................
 .........
......... 
Pratiquement identique pour tous les instruments, on retrouve
une façade en chêne, le reste en sapin, le plafond en toile, mais le trait le
plus original, et sans doute le coup de maître "commercial" a été de faire en
sorte que tous ces instruments soient immédiatement reconnaissables : on retrouve
toujours dans les modèles "classiques" la plate-face de 13+1+13
soit 27 tuyaux du prestant, encadrée de deux tourelles de 5 tuyaux. Si on détaille
chaque façade, on s'aperçoit en fait que les culs-de-lampe ne sont pas tout
à fait identiques, que le feston sculpté sous l'entablement reprend quasiment
le même motif, mais avec des variantes d'un instrument à l'autre, les tourelles
sont surmontées ou non de pot à feu... certains instruments ont été bien sûr
plus ou moins transformés, mais ces caractéristiques restent : même si plusieurs
facteurs en sont les auteurs, cela reste un orgue "Clergeau" !
Le buffet "gothique, lui reste rigoureusement identique d'un
instrument à l'autre. Pourquoi une telle montre dans des instruments se voulant
à la portée de toutes les petites paroisses ? S'agissant du prestant de quatre
pieds, le surcoût était sans doute raisonnable. Pourquoi un seul tuyau écussonné
au centre ? Il est assez rare de trouver des orgues de petite importance avec
une telle plate-face centrale ; en se laissant aller à quelques élucubrations,
on peut remarquer qu'il y a 27 lettres dans le prénom complet Jean-Baptiste-Germain-Clergeau
: est-ce une signature ? Il y a aussi 27 livres dans le Nouveau Testament; les
deux tourelles représentent-elles les deux colonnes qu'on retrouve dans les
temples maçonniques ? On trouve toute sorte de symbolique attachés à certains
nombres (13, 27, 37...) soit en rapport avec l'Histoire Sainte, soit d'ordre
mathématique . Ainsi 3 × 37 = 111, 6 × 37 = 222, 9 × 37 = 333 etc...
On aura compris qu'en cherchant un minimum, on peut associer
facilement un brin d'ésotérisme à cette façade ! Mais pour les quatre buffets
gothiques, rigoureusement identiques et d'apparence un peu lourde, on retrouve
deux tourelles de 3 tuyaux, et une plate-face centrale de 11+1+11 tuyaux, soit
23 tuyaux. Et bien entendu, les nombres 11 et 23 sont riches en significations
symboliques... Et ce grand triangle n'a-t-il aucun rapport avec le compas ouvert
du Grand Architecte ?
Arrêtons là les supputations, l'abbé Clergeau était sans doute
plus homme d'affaires que cabbaliste : il fallait que la façade soit immédiatement
remarquable et reconnaissable, quoi de plus pour attirer l'oeil et donner envie
qu'une belle surface d'étain poli ? Je ne peux m'empêcher de le rapprocher de
manière pragmatique d'une phrase entendue à propos de certaines voitures allemandes
bien connues: "même un paysan du Danube doit pouvoir les reconnaître du premier
coup d'oeil !" ... Et c'est bien le cas pour les orgues Clergeau, un siècle
et demi plus tard ! On lira également avec profit la
description et l'inventaire détaillé réalisé par
M. Rousseau figurant dans le site www.plenumorganum.org
;
à propos des buffets, il faut enfin citer pour l'anecdote,
la confusion de Norbert Dufourq, qui dans son monumental ouvrage "Le livre de
l'orgue Français, tome II: le buffet" N.Dufourq (Picard 1969) attribue la construction
de ces orgues au siècle précédent... Comme il le dit lui-même,
il lui était impossible de vérifier partout l'origine de tous
les instruments.
<<page 184 :En revanche, nous ne pensons pas devoir nous
appesantir devant des meubles - fussent-ils datés, ceux-là - de peu de valeur
intrinsèque. Nous ne pouvons de même nous arrêter à ces petits positifs de 5
à 6 jeux, nombreux dans nos églises de campagne et qui témoignent de l'intérêt
porté par des populations rurales (2) au roi des instruments sous le Bien-Aimé.
L'un de ces spécimens, représentatif du simple positif à deux tourelles de 4
pieds entourant une plate-face unique, se trouve à Chantérac (Dordogne). Quelques
draperies en guise de claires-voies à l'extrémité des tourelles, et un large
fronton orné de volutes et feuillages dominant les tuyaux du compartiment central,
c'est à quoi se réduit le décor de ce petit meuble (3). .... ..... (3) Même
structure, mêmes proportions, même décor au positif de Montpon-sur-l'Isle (Dordogne),
hélas! défiguré par le facteur contemporain qui a flanqué sa façade de gros
tuyaux... d'aluminium. .... page 255: ... (1) Il est particulièrement intéressant,
et peut-être unique en France, de découvrir côte-à-côte - à 15 km de distance
- deux buffets d'orgue jumeaux, conçus sans doute par un même architecte: ceux
de Thieux et de Chaumesen- Brie. Ils comportent l'un et l'autre une plateface
unique de vingt-sept tuyaux avec des bouches à l'horizontale, flanquée de deux
tourelles de cinq tubes, le tout pris sous un même entablement. Une claire-voie
de feuillages branchus à double ou triple volute avec bouquet de fleurs terminal
vient couvrir la partie supérieure de la plate-face. En guise de décor, les
cinq tuyaux de chaque tourelle se trouvent enrobés dans une draperie aux plis
relevés par une cordelière à pompons. Sur l'entablement, le sculpteur a placé
un motif triangulaire avec palmes chantournées, qui sert de support à une croix.
Des pots à feu somment les tourelles. Des jouées pleines avec guirlandes et
volutes à feuilles délimitent les parois latérales du petit meuble.>>
il a cependant le mérite de souligner la parenté
de ces buffets avec le petit positif se trouvant dans la chapelle du Saint-Sacrement
de l'église Saint-Merry de Paris (y-est-il encore?) sur lequel on retrouve
ces mêmes éléments de décor mais avec une plate-face
de 13 tuyaux seulement
 Le livre de l'orgue Français, tome II: le buffet" N.Dufourq (Picard
1969)
Le livre de l'orgue Français, tome II: le buffet" N.Dufourq (Picard
1969)
la composition
dans l'inventaire des orgues
du Limousin 1993, Robert Martin poursuit :
<<Dans le numéro 32 (13ème année) du Bulletin de
Musique Religieuse , il est question d’orgue transpositeur (système de M. l’abbé
Clergeau, Brevet d’Invention S.G.D.G. du 14 avril 1845), et d’orgues à tuyaux
: « … Le clavier peut être placé devant ou derrière – un système d’accouplement
remplace avantageusement les pédales – une bascule qui s’ouvre d’un coup de
genou, donne le plein jeu. Il peut y avoir un buffet à tourelles ou gothique,
avec tuyaux de montre parlante en étain brillant et poli – commander trois ou
quatre mois à l’avance.
- 4 jeux, bourdon, prestant, doublette, flûte, 2 mètres 40 sur 1 mètre 80 1.200
- 5 jeux, bourdon, prestant, doublette, nazard, mi-clairon, mi-hautbois, 2 mètres
50 sur 1 mètre 90 1.500
- 5 jeux ½, bourdon, prestant, doublette, dessus de flûte de 8 pieds, nazard,
mi-clairon, mi-hautbois, 2 mètres 60 sur 1 mètre 95 1.700
- 6 jeux, bourdon, prestant, doublette, Flûte de 8 pieds, nazard, mi-clairon,
mi-hautbois, 3 mètres 1.950
Dans les prix ci-dessus le meuble est en chêne, avec devanture découpée, de
très belle apparence – Pour les orgues de plus grande importance 8 et 10 jeux,
nous envoyons un devis et un fac-similé du buffet … >>Inv.Limousin
1993 ASSECARM EDISUD
la composition est typique, on retrouve une manière de "positif
d'orgue classique" avec un cornet décomposé, sans la tierce
toutefois, et une ou deux anches, ce qui donne :
Flûte 8, Bourdon 8, Prestant 4, Doublette 2, Nazard 2
2/3, Clairon-Hautbois 4-8, Trompette 8, et dessus de cornet posté sur
les instruments les plus complets.
Les plus petits modèles ne comportent ni flûte, ni trompette,
ni cornet, le bourdon en bois assurant la base de la pyramide sonore. Je renvoie
au tableau détaillé figurant dans l'étude citée
au-dessus; à noter cependant l'existence d'un instrument de quatre jeux
(Vinalmont, Wallonie) qui présenterait "une façade d'étain"
alors que les plus petits instruments (Marennes Inv.17) ont une façade
ouvragée composée de volets de bois découpés.
le petit instrument de 5 jeux que je détaille ici
avait la composition suivante (inscriptions au crayon sur les faux-sommiers)
:
Bourdon 8, Prestant 4,
Doublette 2, Nazard 2 2/3, Clairon-Hautbois 4-8,
de quoi assurer les fonds
8 et 4 pour l'accompagnement des chants, une doublette qui éclaircit
la polyphonie, une ébauche de plein-jeu avec l'étagement 8-4-2
2/3-2, et les anches pour donner brillant et solennité à l'ensemble,
même si la basse est de 4 pieds, enfin le hautbois peut chanter en solo,
et même alterner avec le nazard : le nombre de combinaisons sonores réalisables
avec seulement cinq jeux permet de retrouver les principales couleurs de l'orgue
classique ! mais les modes évoluent, et le remplacement du nazard par
une voix céleste pour les instruments plus tardifs en est sans doute
une conséquence, bien dommageable à mon avis...voici à
ce sujet la réponse de mai 2016 à
un échange de courriers à propos du remplacement du nazard par
une voix céleste dans certains instruments :
<<- pour compléter la réponse de Maurice Rousseau
qui pense que les premiers instruments comprenaient un nazard, et que c'est
plus tardivement qu'on trouve une voix céleste, on trouve dans les inventaires
les précisions suivantes : (je reprends les instruments avec voix céleste de
son tableau, dans l'ordre chronologique)
-1855 Chateauneuf en Thymerais : remplacement du dessus de cornet par une Voix
Celeste, et du nazard par une gambe, par les frères Abbey en 1889
-1863 Chaumes-en-Brie la composition indiquée est B 8, Fl 8, Pr 4, ?, D 2, ?,
Htbois8 la voix céleste ne figure pas explicitement dans l'inventaire ; il est
par contre intéressant de trouver le prénom "Emile" Clergeau, et mention de
son associé "Margaine" de la banque "Clergeau et Margaine", ainsi que les propositions
de souscriptions préalables à l'achat des orgues (placements de 1800 F à 5 +
3 %), et achat ultérieur à 2400 F ; mais c'est un autre débat!
-1864 Aouze : dans l'inventaire, l'instrument est commandé à Alizant, avec simple
mention de la ressemblance avec les instruments commercialisés par l'abbé Clergeau,
-1866 St-Nicolas la chapelle : (prix d'achat : 5000 F !) plusieurs restaurations,
dont Tschanun 1873
-parmi les instruments non datés : Monterblanc (56) installé par Debierre en
1894, qui "récupère du matériel provenant d'un orgue Clergeau" Maxent (35) en
provenance de Tinténiac : "Yves Sévère ne replace pas le salicional en mauvais
état..."
en conclusion : -le remplacement d'un nazard est avéré dans au moins un instrument
de 1855, il n'est pas impossible que ce soit également le cas dans d'autres,
ayant subi des transformations, mais nous n'avons pas les dates
-les orgues d'Alizant de Aouze (1864) et Soulosse (88) 1866 comportent bien
une voix céleste dès l'origine peut-on donc en conclure que jusque vers 1862-63
on trouvait un nazard, puis ensuite une voix céleste (ou quelquefois un salicional)
? seul un examen plus complet des archives et des instruments pourra préciser
la date de la "transition" >>
...
haut de page
l'homme
d'affaires, les sociétés, et la faillite
replaçons
nous au milieu du XIXème siècle : sous la IIème République,
la loi Falloux remet à l'honneur les écoles libres, et permet
une mainmise importante du clergé sur l'enseignement primaire. Sous le
Second Empire, Napoléon III reste bienveillant envers l'église
catholique, ce qui conforte l'influence de l'Eglise, et les prêtres jouent
un rôle très important, non seulement auprès des populations
rurales, mais aussi auprès de la bourgeoisie. Un grand nombre d'églises
de campagne date de cette époque, construites grâce à des
dons, des legs, et certains prêtres vont outrepasser leur rôle spirituel
et religieux, pour s'interesser davantage à l'aspect financier... de
nombreuses congrégations voient également le jour, et les capitaux
et les sommes mis en jeux ne laissent pas indifférents certaines personnes.
citons
deux personnages avec lesquels on pourrait faire un lointain parallèle
: Louis de Coma, né en 1922, curé de Baulou, et Béranger
Saunière (né en 1852), curé de Rennes-le-Chateau dont une
partie des ressources provenait de "trafic de messes" ou de courtages
de dons, c'est à dire la récolte de fonds auprès de paroissiens,
ou de congrégations, pour dire des messes (mais en quantité industrielles!)
ou faire des retraites spirituelles payantes, pratiques en général
condamnées par l'autorité ecclésiastique. Dans les deux
cas, sont mises en jeu des sommes importantes, même si on évoque
la découverte d'un trésor dans le cas de Béranger Saunière.
On parle également de "carnets" ou de "répertoires"
de personnes ou congrégations prêtes à donner (ou placer?)
de l'argent. Il ne faut pas, bien sûr généraliser à
l'ensemble de clergé, mais il est établi qu'on a pu rencontrer
de telles pratiques ici ou là.
La commercialisation du mécanisme transpositeur a du permettre justement
à l'abbé Clergeau, de se constituer un réseau de correspondants
jusque dans les plus petites paroisses : il suffit de consulter l'annuaire des
diocèses, puisque chaque paroisse a une église susceptible d'accueillir
un harmonium ou un orgue, et un desservant pouvant susciter des dons auprès
de ses paroissiens ou de congrégations. De là à proposer,
en plus d'un instrument, de bons placements, avec retour spirituel (messes,
indulgences) mais aussi plus matériel (il est question de 8% dans certains
articles...), il semble que l'abbé Clergeau ait franchi allègrement
le pas, et dès 1846!
<< [en 1860]... Mr
l'abbé Clergeau, ancien aumonier etc..publie depuis quatorze années
[soit depuis 1846] un Bulletin financier destiné à indiquer à
ses vénérables collègues les placements de fonds qu'il
croit les plus avantageux par son entremise...>>
et ce aidé par une distribution de prospectus, destinés à
vanter 1) les mérites de l'orgue-transpositeur; 2) une méthode
pour former un organiste en quelques semaines; 3) et sans doute...quelques bons
placements avec un bon rendement, comme on le découvre
par exemple dans l'inventaire de Seine-et-Marne, (Klincksieck éd.1991)
où Pierre Dumoulin rapporte à propos de l'orgue de Chaunes-en-Brie,
que la même maison propose service de banque et vente d'orgues :
<<Le conseil de fabrique se réunit en séance extraordinaire
le 3 février 1863. Au cours de cette réunion <<Mr le Curé
demande la parole et expose que la fabrique ayant actuellement en caisse une
somme de mille huit cents francs destinée au paiement de l 'orgue dont
l’acquisition a été décidée, il serait à
propos de ne pas laisser cette somme improductive; que la dite somme pourrait
être placée à la caisse de MM. Émile Clergeau, Marg.
.. et Cie au taux annuel de 5 % d’intérêt et 3 % de prime
à titre d’œuvre pieuse.
M. le Président, ayant mis la question aux voix, le conseil a pris la
décision suivante: 1) la somme de mille huit centfrancs sera déposée
à la caisse de MM. Émile Clergeau, Marg... et Cie pour produire
intérêt au taux de 5 %, plus 3 % à titre d’œuvre
pieuse, jusqu’au premier septembre prochain ».
Au cours de la séance suivante, le 12 avril 1863, réunissant les
membres du conseil de fabrique, <<M. le Curé, ayant demandé
la parole, rend compte des démarches qu’il a
faites pour l’acquisition d’un orgue. Le conseil se trouvant sufisamment
renseigné sur cette question est d’avis que le dit orgue, composé
de 7 jeux, soit acheté pour l’église et
charge M. le curé, de concert avec M. And... et M. Martinet de négocier
cette affaire avec la maison Clergeau et lui donne toute liberté d’action
jusqu’à concurrence de mille
quatre cents francs>>.
La décision du conseil de fabrique est maintenant bien arrêtée
et le facteur choisi travaille avec diligence car «le jour de l’Assomption
I863, le joli et excellent petit orgue
qui se dresse fièrement et coquettement au milieu de la tribune, commença
de se faire entendre, quoiqu’il n’y eût encore qu'une partie
de ses jeux disponible. Il fut fait par
M. Alisan (ou Alison?), facteur distingué de la maison Clergeau, rue
du Val de Grâce, 18, à Paris. Il a coûté, en place,
environ 2 400 francs ».>>(somme bien supérieure à
celles évoquées dans ses prospectus, voir ci-dessus "composition",
s'agit-il d'une erreur de retranscription?)
l'abbé Clergeau devient alors actionnaire, associé, fondateur
de sociétés (société des orgues, société
des bonnes Oeuvres), gérant de banque, dirigeant, chef d'entreprise...
-prorogation de la société en
nom collectif "Clergeau-Margaine", avec procuration à Emile
Clergeau, "parent", dans la gazette des tribunaux du 16 janvier 1864,
on lit :
<<au terme d'un acte...intervenu entre : M. Jean-Baptiste-Germain Clergeau,
(Paris, 28 rue des Tournelles), Mr Auguste Margaine (Paris, rue St-Gilles, 1x)
et M. Emile Clergeau, demeurant à Paris rue Duval, 3, il appert : -que
la société en nom collectif existant entre les sus-nommés
sous la raison sociale "Emile Clergeau, Margaine et cie", dont le
siège est à Paris, rue des Tournelles, 28, et sous le nom générique
de Maison de banque-A été [prorogée?] de six années,
qui expireront le 31 décembre 1870 -laraison sociale continue à
être Emile Clergeau, Margaine et cie-la signature appartient à
M. Jean-Baptiste-Germain Clergeau -enfin le siège social reste établi
à Paris, rue des Tournelles, 28 >>
cet "Emile Clergeau", auquel on a quelquefois attribué des
orgues ou des harmoniums, et désigné dans les actes juridiques
comme "parent", apparaît dans cet extrait d'arbre généalogique
: extrait
de l'arbre généalogique de la famille Clergeau en lien de parenté
avec l'abbé Clergeau le lien de parenté n'est pas connu à
ce jour, mais compte-tenu des âges respectifs de chacun, de la confiance
qui est placée en Emile, qui obtient procuration pour une "maison
de banque", du fait qu'il s'agit du frère de Jeanne-Alexandrine
qui épousera Auguste Alizant, l'hypothèse que Emile et J-Alexandrine
soient les neveu et nièce de l'abbé ne paraît pas si fantaisiste!
dans
l'ouvrage "naissance
du patronnat de Jean Lambert-Dansette tome II le temps des pionniers 1830-1880
(L'Harmattan)" au ch.6:
<<"les classes moyennes" l'auteur nous apprend
qu'en 1859, la Société des Eaux de Calais, chargée d'amener
l'eau issue de sources vers la ville, devient "Clergeau et Cie">>
on découvre également que l'abbé Clergeau était
associé à un certain Margaine pour diriger une maison de banque
"Clergeau et Margaine" et qu'en 1866, c'est la faillite, les associés
sont poursuivis et condamnés, des sommes considérables étant
en jeu...
Mais les qualités de gestionnaire et peut-être l'honnêteté
n'y étaient sans doute pas, d'où la faillite, et la condamnation
qui surviennent bientôt :
-selon la Gazette des tribunaux du 13 juin 1866
: <<Jugement du tribunal de commerce de la Seine du 8 juin 1866, lequel
dit : Que le jugement du 30 mai 1866, déclaratif de la faillite des sieurs
Clergeau et Margaine, négociants, demeurant à Paris, rue des Tournelles
28, s'applique à la société en nom collectif G.Clergeau
et Margaine ayant pour objet les opérations dites de banque et la fabrication
et la vente d'orgues, et siège à Paris, rue des Tournelles, 28
pour la maison de banque, et rue du Val-de-Grace, 18 pour la maison d'orgues,
ladite société composée de 1° Jean-Baptiste Germain
Clergeau, demeurant à Paris rue des Tournelles, 28 ; 2° Auguste-François
Margaine, demeurant à Paris, rue St-Gilles, 12, ; déclare en conséquence,
en tant que de besoin et comme ayant fait partie de ladite société,
en état de faillite ouverte : 1° Jean-Baptiste Germain Clergeau,
demeurant à Paris rue des Tournelles, 28 ; 2° Auguste-François
Margaine, demeurant à Paris, rue St-Gilles, 12 ; Dit que le jugement
vaudra rectification et complément en ce sens du jugement déclaratif
de faillite du 30 mai dernier, et qu'à l'avenir les opérations
de la faillite seront suivies sous la dénomination qui précède
(n°6214 du greffe).>>
-Gazette des tribunaux du 11 octobre 1866 :
<<convocations de créanciers...de la société en nom
collectif G.Clergeau et Margaine ayant pour objet les opérations dites
de banque et la fabrication et la vente d'orgues, et siège à Paris,
rue des Tournelles, 28 pour la maison de banque, et rue du Val-de-Grace, 18
pour la maison d'orgues... le 1? octobre à 1? heures>>
extrait de "la grande
bohème d'Henri Rochefort 1866"
<< L'abbé Clergeau l'a bien compris lui ; aussi, au lieu de se laisser
prendre et envoyer àCayenne, où il eût été peut-être obligé de violer,
comme condamné, le vœu de célibat qu'il avait fait, comme prêtre, est-il parti
subitement pour l'étranger, en allégeant ses actionnaires de la Société des
bonnes œuvres: d'une somme de cinq millions qui les gênaient, il faut croire,
et qui les gêneront bien davantage, maintenant qu'ils ne les reverront plus.
J'ajouterai que les porte-monnaie compromis dans cette culbute ne m'inspirent
aucune pitié. En effet, cette société dite des bonnes œuvres était tout simplement,
une banque qui promettait aux petits capitaux des intérêts disproportionnés.
Le titre qui était donc déjà un spirituel mensonge aurait dû éclairer les participants
à des combinaisons désavouées par la morale : — L'abbé Clergeau, il est vrai,
peut répliquer que ladite société a été réellement une bonne œuvre pour lui
qui a récolté cinq millions : mais cette interprétation n'aurait sans doute
pas plus de succès que l'argumentation du dentiste qui arrachait en plein vent
les dents sans douleur, et, quand on lui faisait observer que ses victimes poussaient
pendant l'opération des cris épouvantables, répondait tranquillement : — Elles
poussent des cris, c'est vrai ; mais ce sont des cris de joie. L'abbé Clergeau
n'en est pas moins parti, comptant sur la charité chrétienne pour consoler ceux
qu'il a dépouillés. Il s'est 'probablement tenu, avant de s'exiler, ce raisonnement
où éclate à la fois la logique et la confiance en Dieu. — S'ils meurent de misère
ici-bas, le Seigneur les récompensera là-haut. Voilà comment les hommes intelligents
profitent de tout, même de l'immortalité de l'âme, pour imposer silence à leurs
scrupules>>
dans le journal quotidien "Le Mousquetaire", il est fait référence
à une "Société des orgues": s'agit-il de la société
qui commercialisait les petits instruments dans toute la France, et jusqu'en
Belgique, entité bien différente des ateliers de facture d'orgues
qui fabricaient les instruments ?
<<tribunal correctionnel de paris 6ème chambre Président
Delesvaux : escroqueries, abus de confiance, l'abbé Clergeau et ses diverses
sociétés: la société des orgues, le crédit
des paroisses, la caisse des bonnes oeuvres, la banque des dépots, les
eaux de Calais, la société des institutions de Boulogne et de
Saint-Mandé ... sont impliqués trois prévenus : l'abbé
Clergeau, le sieur Margaine et le sieur Faure dit de Monginot ... ("Le
Mousquetaire, Paris et départements" Lundi 8 Avril 1867)
résumé de l'article: venu
à Paris pour exploiter en grand un procédé dont il se disait
l'inventeur, il était arrivé à réaliser en très
peu de temps un bénéfice de 400.000 fr ... plus tard il ouvrit
une banque de dépot et fit appel tout particulièrement au membres
du clergé à qui il promettait un intérêt de 8% ...
mais s'engageant en 1859 dans la Société des Eaux de Calais qui
était dans une situation déplorable, il acheta à bas prix
une multitude d'actions, qu'il revendit bien plus cher à ses commettants
; il se trouva ainsi seul maître de l'entreprise ... l'ancien directeur
de la société des eaux, Guizelin porte plainte contre lui et son
neveu ... à cette époque le chiffre des dépots à
lui confiés s'élevait à la somme de plus de deux millions,
et cependant il existait déjà un déficit de 800.000 francs
... c'est encore à cette époque que pleuvaient des prospectus
mensongers qui ont amené de nouveaux versements...
... déposent ensuite des membres du clergé
[dont le curé d'Isigny] qui ont fait des dépots, mais n'ont jamais
vu les intérêts que sur le papier et dont le capital s'est envolé...
... le tribunal, après délibération
... a condamné l'abbé Clergeau (par défaut) à cinq
ans de prison et 50 fr d'amende, et le sieur Margaine à trois mois de
prison et 50 fr. d'amende>>
notre abbé semble
désormais bien loin des préoccupations liées à la
propagation du chant choral dans les campagnes
-Le Journal des Economistes 4 Juin 1867 : <<Voici
ce que deviennent quelques-unes de ces entreprises de crédit baptisées
de grands noms et annoncées avec audace. Nous lisons dans un journal quotidien:
" Un prétre, l'abbé Clergeau, ancien curé d'une paroisse de Bourgogne, ancien
vicaire du chapitre de Sens, venu a Paris, il y a plus de vingt ans, pour exploiter
un procédé dont il se disait l‘inventeur, un nouveau sys tème de transposition
pour le clavier des orgues, n'a pas tardé a y occuper une position industrielle
considérable. S'adressant plus particulièrement à ses anciens collègues,
aux curés et desservants de campagne, par des lettres, par des prospectus, par
des circulaires, il leur demandait le dépôt de leurs fonds ou de titres représentant
des valeurs cotées à la Bourse, en leur promettant de leur servir un intérêt
de 8 %. Séduits par l’appât de ce bénéfice un peu usuraire, bon nombre d'ecclésiastiques
ont confié leurs fonds ou leurs valeurs à l’abbé Clergeau, qui, toujours proclamant
le succès de ses entreprises et promettant de plus grands avantages, a fondé
successivement six établissements sous les noms de : la caisse des Bonnes
œuvres, -le Crédit des pa roisses, -la banque des Dépôts, -les Eaux de Calais.
-la Société des institutions de Boulogne et de Saint-Mandé. Le résultat
de toutes ces entreprises a été une faillite présentant un passif de plus de
4 millions en face d'un actif de 60,000 fr., ensuite de laquelle s‘est dressée
contre l'abbé Clergeau et deux de ses associés, les sieurs Faure (dit de Monginot)
et Margaine, une triple prévention de banqueroute simple, d'escroquerie et d’abus
de confiance. Bon nombre de témoins ont été entendus, presque tous des ecclésiastiques,
curés et desservants de divers départements. Tous ont déclaré qu'ils ont été
trompés par l'abbé Clergeau, auquel, avec la plus grande confiance, ils ont
envoyé leurs fonds ou des valeurs pour en faire un emploi déterminé; le résultat
a été pour eux un désastre complet; quelques uns out été désintéressés, non
par l‘abbé Clergeau, mais par ses associés. Le syndic de la faillite a déclaré
que l‘abbé Clergeau percevait pour son traitement particulier une somme de 23,000
fr., menait un grand train et avait une maison de campagne à Enghien. .
L'abbé Clergeau, qui depuis longtemps est en fuite, ne s'est pas présenté à
l'audience. Le tribunal correctionnel, 6e chambre, présidé par M. Delesvaux,
a donné défaut contre lui, et l'a condamné sur tous les cbefs de la prévention
à cinq ans de prison et 50 fr. d’amende. Le sieur Margaine, pour complicité
de banqueroute simple et d'abus de con?ance, a été condamné a trois mois de
prison et 50 fr. d'amende. (Siècle) Joseph Garnier. Le Gérant, Paul BRISSOT-THIVARS>>
les sociétés
financières ne sont pas seules concernées par cette débâcle
: faillite de l'entreprise Alizant-Clergeau à Mirecourt en 1867...ce
qui n'empêchera pas de retrouver plus tardivement deux ou trois instruments
identiques aux autres, ce qui prouverait qu'un vrai atelier de facture d'orgues,
vraisemblablement celui du père d'Auguste Alizant qui survécut
deux ans à son fils, ait pu survivre à la liquidation.
rappelons
ici la conclusion de son ouvrage "L'unique destinée de l'Homme"
:
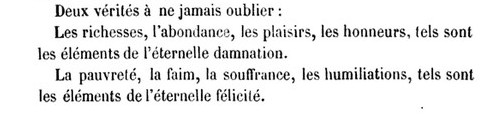
***
d'autres extraits dans
la presse :
<<.. Les opérations de l'abbé Clergeau
fondateurd'une prétendue Caisse de bonnes oeuvres et qui est en fuite, avaient
été blâmées sévèrement et à plusieurs reprises par l'autorité ecclésiastique,
et notamment, croyons-nous, par l'archevêché de Paris. On nous assure que la
banqueroute de l'abbé Clergeau a des ramifications avec une affaire de détournements,
où se trouvent compromis un imprimeur de Paris, et le sous-caissier d'un de
nos grands établissements de crédits. (Liberté.) Ch. Virmaître.>>le journal
de Toulouse samedi 1er septembre 1866
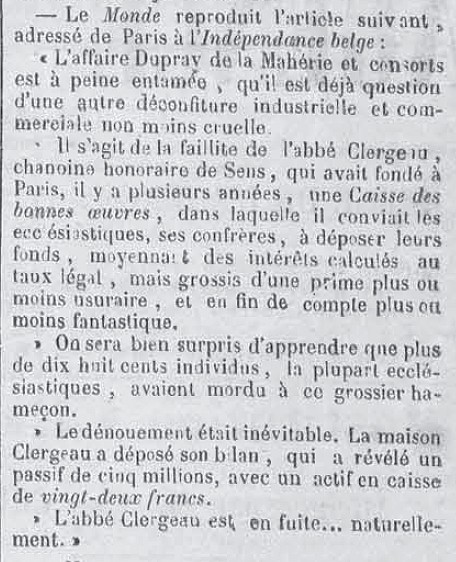 le journal de Toulouse samedi 3 septembre 1866
le journal de Toulouse samedi 3 septembre 1866
<<...Les déplacements et villégiatures sont plus que jamais
à l'ordre du jour dans le monde de la finance et de la caisse. C'est d'abord
l'abbé Clergeau, fondateur de la Caisse des Bonnes Oeuvres qui vient de partir,
laissant un passif de cinq millions et un actif de vingt-deux francs. Puis le
caissier d'un des principaux commerçants de Bordeaux. Puis encore le caissier
d'un agent de change parisien. Disparus l'un et l'autre, en laissant vides les
coffres de leurs patrons respectifs...>> JOURNAL DE LA SAVOIE DU 2 SEPTEMBRE
1866 (www.memoireetactualite.org)
où sont partis Clergeau et ses associés ? l'argent disparu a-t-il
été réutilisé ailleurs ? comment le personnage a-t-il
fini sa vie, et où ?
toutes questions auxquelles il n'y a pas de réponses pour l'instant
!
Août 2012
...
autres références
non exploitées (recherches en cours):
(<<...Une circonstance
assez singulière c'est que l'abbé Clergeau occupe une cellule à côté de celle
de M. Mirés...>>journal de l'Ain vendredi 19 juillet) 1861(www.memoireetactualite.org)
la date 1861 est curieuse
(note sur l'affaire Bapsubra-Clergeau
<<Affaire Bapsubra-Clergeau. Note noms cités Bapsubra, Jean-Baptiste-Germain
Clergeau (Abbé.), Galland et Cie "De Guizelin Éditeur impr. Pillet fils aîné,
1859>> s'agit-il d' Achille Bapsubra employé en 1857 au journal
"la revue de Paris" ou un homonyme ? on retrouve également
trace d'un Jean-Achille Bapsubra, né à Toulouse, ancien greffier
de la prison Saint-Lazare, qui <<...organisait dans l'austère prison
de petites fêtes intimes...il parait même qu'on dansait au son de
l'harmonium de la chapelle...>> l'histoire ne dit pas s'il avait un clavier
transpositeur...(la commune de Paris, l'Assistance publique et les hopitaux
en 1871 Jean-Paul Martinaud Ed. L'Harmattan)
(Journal du Palais, pages
721-723 arrêt de la cour de Cassation 29 novembre 1871 concernant la rétention
de pièces lors de la faillite :
<<...l'abbé Clergeau associé de la maison de banque Clergeau
et Margaine avait été gérant pendant neuf années
de la Société des Eaux de Calais...>>)
(Lettre de l'abbé Clergeau
pour remercier le Conseil municipal de Calais d'une subvention qui venait de
lui être votée. Paris, le 16 janvier 1877.)
...
haut de page
accueil
... l'abbé
Clergeau ... tableau
des orgues ... inventaire
en images ... autres
instruments ....l'orgue
"de Sète" .. sources
... contact
 Nous n'avons hélas pas de portrait, mais il serait né à
Auxerre le 29 mars 1805, aurait été ordonné prêtre
en 1828, et pris sa retraite ecclésiastique en 1844 (archives diocésaines
de Sens, communication de J.M. Cicchero
facteur d'orgues) ; il est cependant toujours cité comme "chanoine
honoraire de Sens", avec toujours le titre d'abbé, y compris lors
de ses démêlés judiciaires...
Nous n'avons hélas pas de portrait, mais il serait né à
Auxerre le 29 mars 1805, aurait été ordonné prêtre
en 1828, et pris sa retraite ecclésiastique en 1844 (archives diocésaines
de Sens, communication de J.M. Cicchero
facteur d'orgues) ; il est cependant toujours cité comme "chanoine
honoraire de Sens", avec toujours le titre d'abbé, y compris lors
de ses démêlés judiciaires...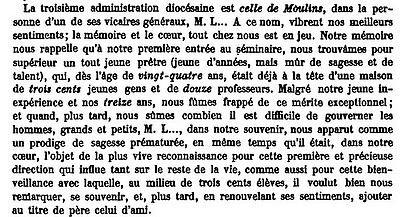 "Chateaubriand, sa
vie publique et intime, ses oeuvres"(Paris, Dufour, Mullat et Boulanger
1860)
"Chateaubriand, sa
vie publique et intime, ses oeuvres"(Paris, Dufour, Mullat et Boulanger
1860) 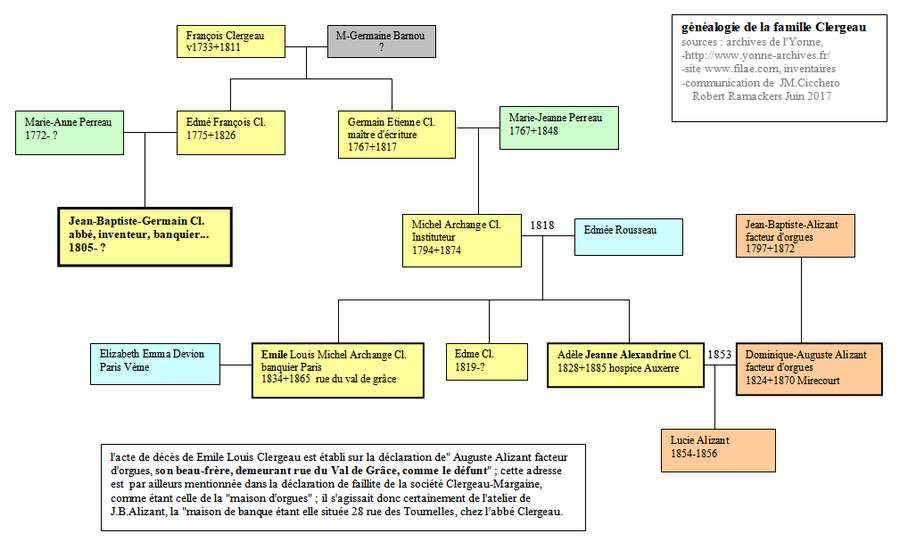
 .........................................
......................................... 
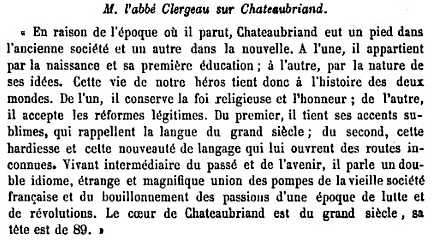 à rapprocher de l'orgue Clergeau très "ancien
régime", en plein milieu du XIXème siècle...
à rapprocher de l'orgue Clergeau très "ancien
régime", en plein milieu du XIXème siècle...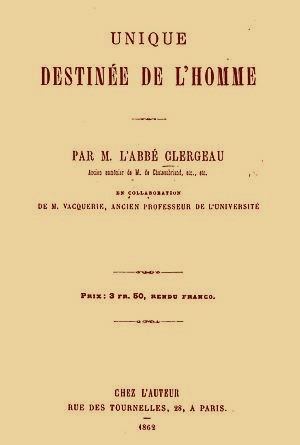 .....
.....
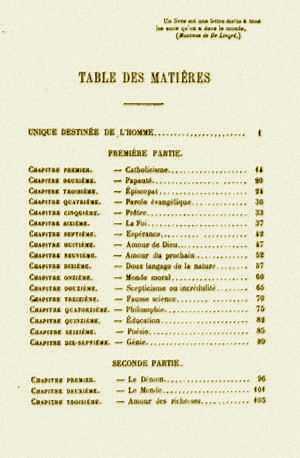
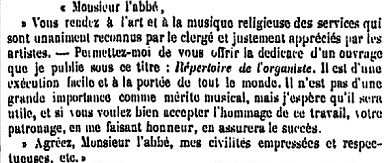 "l'univers musical" dédicace de Fessy 1er janvier
1856
"l'univers musical" dédicace de Fessy 1er janvier
1856

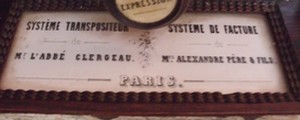
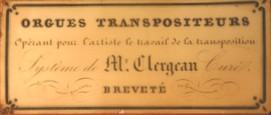

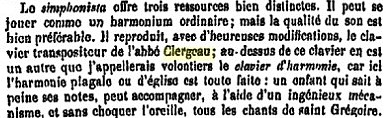 journal "l'univers musical" Paris Bruxelles 1er Janvier
1856
journal "l'univers musical" Paris Bruxelles 1er Janvier
1856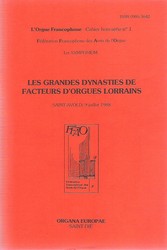 Ed Organa Europae BP16 88101 SAINT-DIE CEDEX
Ed Organa Europae BP16 88101 SAINT-DIE CEDEX .........
......... 
 Le livre de l'orgue Français, tome II: le buffet" N.Dufourq (Picard
1969)
Le livre de l'orgue Français, tome II: le buffet" N.Dufourq (Picard
1969) 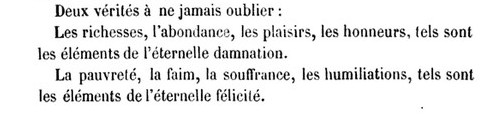
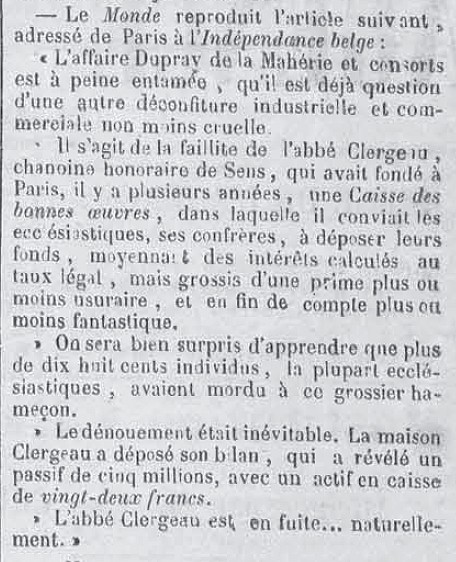 le journal de Toulouse samedi 3 septembre 1866
le journal de Toulouse samedi 3 septembre 1866